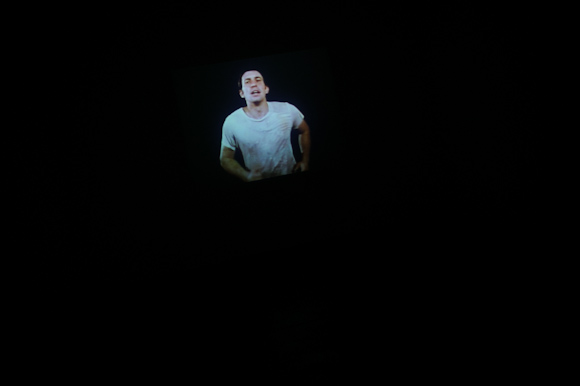Laurent Huguelit est un « praticien chamanique, auteur, peintre et enseigne les techniques fondamentales du chamanisme dans le cadre de séminaires et stages » (biographie réduite extraite de son site).
Avec son accord, je publie une correspondance électronique que j’ai eu avec lui il y a quelques mois. Elle présente les liens entre art et chamanisme et le pont reliant ces pratiques à la position de l’homme dans la société et dans sa propre vie.
« Deux niveaux » : message initial envoyé en septembre 2010.
Bonjour Laurent,
Je suis Jean-Romain Pac, photographe de l’INREES. Alors que je réalisais les photos lors de la conférence que vous avez co-animée avec Olivier Chambon il y a quelques mois, j’écoutais en même temps vos propos.
Vous avez parlé, à un moment, de la dureté et la complexité des relations humaines, très politisées, dans le monde des chamanes. Je ne connais pas du tout ce domaine donc je vous prie de m’excuser si les termes que j’emploie manquent de précision voire de justesse.
Le monde tel que la plupart des personnes le connaissent semblerait alors, après une expérience chamanique, très léger, simple et presque « dérisoire ».
En somme, ce que j’ai compris de votre intervention est que l’univers des chamanes est intense mais aussi impitoyable et violent. De fait, lorsque votre esprit retourne dans le monde que nous connaissons, un détachement naturel s’opère car en relatif, il paraît sans profondeur ou sans difficultés.
Je ne sais pas si j’ai bien compris mais ce qui est sur c’est que cela a fait écho dans mon esprit et avec ce que je suis en train de vivre actuellement. Mon intérêt pour l’art est de plus en plus marqué et je suis dans un tournant de ma vie où je dois faire un choix, celui de peut-être vivre dans l’inconfort intellectuel et l’épanouissement artistique. Celui où on doute, on se questionne et se remet en cause en permanence. Je désire effectivement m’orienter vers la photographie d’art.
J’éprouve alors ce sentiment que ma vie d’avant et la vie actuelle de bien de mes amis baignent dans la légèreté et le superficiel (ce qui est très bien en soi ! je n’ai pas de jugement de valeur sur ce sujet / Cf. mon article où je fais l’éloge de la futilité !). Bref, en somme je crois que plus on vit ou on aspire à vivre des expériences dures mais intenses, le reste nous semble simple. Lorsque je dois pour des raisons financières, réaliser une mission non-artistique, tout est simple et en règle générale, je la réalise sans encombres !
C’est encore un peu confus dans mon esprit donc je ne sais pas si mon propos est très limpide mais je ressens un parallèle assez évident entre ces « deux mondes » et ce que peut vivre intérieurement un artiste.
Voilà, c’est tout :-) Je voulais juste vous faire partager ma vision à ce sujet. En tout cas merci pour votre intervention à l’INREES qui m’a permis de comprendre un tout petit peu mieux le chamanisme (étant totalement profane sur ce sujet, la route est longue !).
Jean-Romain Pac.
Réponse de Laurent Hugelit
Bonjour Jean-Romain,
Tout d’abord, je tiens à vous remercier de partager vos questionnement avec moi. Les questions que vous soulevez sont fondamentales.
Voici un exemple : lorsque les colons sont arrivés en Amérique, ils ont avant tout été choqués par le fait que les peuplades indigènes passaient leur temps à flâner, à glandouiller, à peindre, à faire la sieste et à élever leurs enfants… et très peu de temps à se plaindre de la difficulté de la vie ; c’était bien évidemment scandaleux ! Et pourtant, cela résume bien l’approche chamanique : le travail des chamanes est tellement concentré et intense — l’anthropologue Michael Harner va jusqu’à parler de « combat héroïque » –, que le reste de l’existence dite « ordinaire » perd ses qualités dramatiques. Restent la détente, l’émerveillement et un détachement non sans humour… la futilité, dans toute son éclatante beauté.
Dans mon prochain livre (c’est un scoop), je dis ceci : aimer la trivialité est la clé du travail chamanique, parce que c’est la trivialité qui nous ramène sur Terre et nous prévient de devenir des allûmés mystico-intellos. Ou des chamanes qui n’arrivent pas à décrocher et continuent, même dans la réalité ordinaire, à se battre, ce qui donne au final un embrouillamini de relations complexes… et là, effectivement, ça devient politique. De mon côté, je me considère plutôt comme un plouc qui fait bien sont travail et cherche à simplifier, simplifier, simplifier encore ; parce que justement, comme vous l’avez relevé, le travail chamanique (ou artistique) demande une telle implication corps et âme, que le reste du temps se doit d’être un peu apaisé (ce qui n’est pas toujours évident).
Ce qui est au centre de tout cela, c’est le rapport au temps, qui est géré de manière duale dans le chamanisme : il y a le travail chamanique dans l’autre monde, très intense, durant lequel le temps est compressé au maximum et les enjeux très complexe, profonds, subtils, etc. En passant par exemple une heure en état modifié de conscience, le facteur temps/émotions/acquisition de savoir est démultiplié, ce qui permet ensuite, dans la vie ordinaire, de laisser le temps faire son travail… donc de glandouiller en attendant que les résultats apparaissent. C’est une approche temporelle stratégique, que nous avons un peu perdue dans notre culture urbaine en particulier, puisque le temps est devenu un coursier que rien ne semble arrêter et que nous cherchons en vain à rattraper. Nous sommes devenus les victimes de notre outil.
Il ne fait aucun doute que les artistes sont des chamanes (et vice versa), et que le rapport entre l’intensité du travail et le reste de la vie (que l’on choisit simple ou pas ; c’est une question de choix, d’affinité) pose les mêmes questions ; lorsque je fais du travail chamanique, que je peins ou que j’écris, l’intensité du travail, avec ses hauts et ses bas, ses questionnements proprement existentiels, me nourrit et me permet ensuite de simplement jouir de la vie.
J’aime beaucoup votre représentation graphique en pyramide [1] ; cela résonne avec mon prochain livre ; mais j’y ai ajouté des étages au-dessus du futile (ou plutôt en parallèle, car il y a toujours une approche multidimensionnelle de la réalité à prendre en compte… et difficile à représenter). À suivre, donc.
Dernièrement, je suis allé voir une importante exposition sur Basquiat et j’ai également eu cette impression : la découverte d’un chef d’œuvre [2].
Bien à vous,
Laurent.
Références au blog
[1] Article « La futilité est un signe d’évolution ! »
[2] Article « J’ai découvert un chef d’œuvre ! »
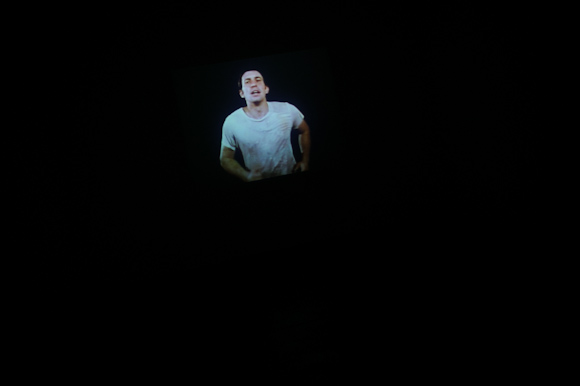
Photo de l'exposition "Fresh Hell" au Palais de Tokyo. Novembre 2010. Photo : Jean-Romain Pac.