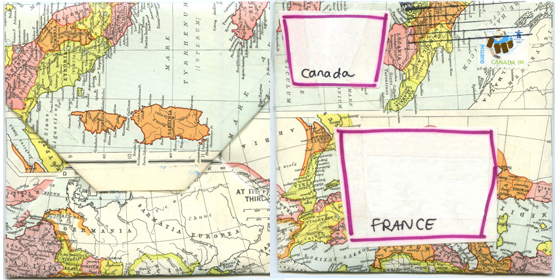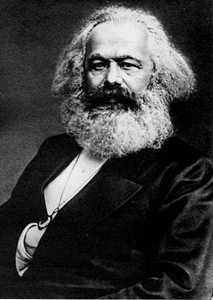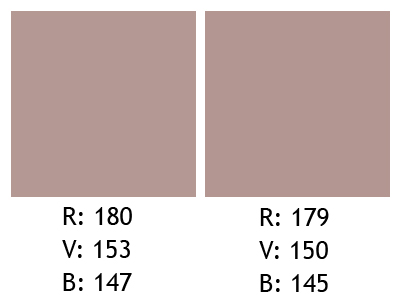Avant de partir pour l’Espagne, je réalisais un portrait de Thierry Janssen. Tel un message prémonitoire, lorsque j’arrive en plein milieu de l’interview, on me présente : Jean-Romain, le photographe.
Thierry Janssen s’arrête, se tourne vers moi et me demande de répéter mon prénom. Je m’y applique et il reprend : Jean-Romain, c’est un joli prénom. Vous savez Jean ça veut dire lumière, d’ailleurs la fête de la Saint-Jean est la fête des lumières. Jolie destinée d’avoir la lumière dans son prénom pour un photographe dis-je à voix haute ! L’interview continue et je photographie.
Cette transition vers mes vacances, sous forme de clin d’œil à ce qui allait se passer dans ma tête quelques jours plus tard introduisit mon escapade ibérique. Madrid, puis Séville.
Le train part de la capitale après y avoir passé quelques jours entre amis. Le AVE (Alta Velocidad Española) démarre pour rejoindre le Sud, toujours plus chaud et lumineux. Un homme à l’uniforme de la compagnie ferroviaire s’avance en ma direction et d’un élégant « ¿ Señor ? » me tend des écouteurs à brancher sur le siège pour profiter du voyage en musique.
Je les branche, choisis le premier canal proposé et la poésie opère. Alors que la lumière de fin de journée se lève, le train avance à une allure parfaite et, doucement, je reçois de la musique espagnole typique – du flamenco – plein mes oreilles. Quelque part, ce n’est qu’à ce moment là que mon voyage a véritablement commencé car il était introspectif et profond.
La capitale andalouse prend le temps. A l’arrivée, je me mets à son rythme (ou son absence). Pour un citadin moderne, ça devient une vraie gageure de ne plus regarder sa montre pour juste apprécier le moment.
Étalés sur plusieurs jours, mes balades m’amènent à des visites et rencontres fortuites ou préméditées.
Il y’a cette charmante Giralda. Ne lui demandez pas son âge, c’est impoli pour les demoiselles et encore plus pour les dames car celle-ci à plusieurs siècles d’existence. Le minaret de Séville a été commandé et construit au XIIème siècle par le calife Abu Yaqub Yusuf.
Puis, ce new-yorkais de naissance dont le nom m’a échappé qui exposait ses photographies dans la rue, en face de la cathédrale. Il a passé la majeure partie de sa vie dans les pays hispanophones. On a discuté photo, futur, vie et je suis reparti avec la photo de mon choix en guise de reconnaissance de notre amitié naissante. C’est derrière ce sublime portrait de deux péruviennes, une mère et sa fille à côté, la mère tenant une brebis que le photographe a écrit « Para Jean-Romain. Ha sido un placer conocerte. Espero verte en Paris. Tu amigo, sa signature. 9 de julio, Sevilla, España ».
La plaza de Torros de Séville, le parc des Princes local, l’élégance et la connaissance en plus. Voici ce que j’ai écrit dans mon carnet
Tel un flash, les murs entourant la Plaza de Torros – les arènes – de Séville éblouissent.
La lumière est forte et les couleurs solaires. Blanc pur pour les murs, ocre pour le sable de l’arène, rouge pour les portes et jaune pour quelques éléments décoratifs.
La forme ovale de l’arène (suite à une erreur de conception) nous amène à y trouver une connexion spatiale, transcendantale. Tout est beau, fin et la guide souligne le passé, tant d’un point de vue architectural que sur la corrida elle-même. Elle est habillée avec une chemise blanche et un tailleur rouge : quel plaisir pour mon œil de recevoir autant de couleurs « primaires » dans ce voyage !
Les toréadors sont animés par une véritable passion. C’est même encore plus fort : la corrida, c’est leur vie, et leur mort pour certains tristes destins.
Les picadores, cavaliers aux grandes lances ouvrent le bal, puis ce sont les peones qui posent les banderilles. La cérémonie continue avec le matador, âgé de 16 à 60 ans (28 ans étant l’âge d’or) qui entre en scène et fait le spectacle. Malgré cet aspect léger, en Espagne et surtout à Madrid et Séville, la corrida est une véritable institution avec ses familles de toréros et d’éleveurs de taureaux (ganaderías).
Le taureau qui rentrera le lendemain nous dit-on est jeune : quelques trois années alors que la moyenne se situe de 4 à 6 ans.
La guide nous montre les hauts-lieux de l’événement hebdomadaire. La chapelle donne sur la puerta mayor – la porte principale – pour que les familles et les toréros y prient avant l’entrée sur l’arène. On habille les chevaux des picadores juste derrière avec des vêtements décorés, onéreux et colorés.
Enfin, la porte principale est le centre de la nervosité générale où des dizaines de proches viennent soutenir le matador. Une corrida, ce sont trois matadores donc trois familles distinctes.
En fonction de l’emplacement et de la renommée du toréro, le prix des places varie énormément. Les billets les plus chers peuvent dépasser les 100 euros.
La cérémonie dure environ 2 heures 30. Une fois que le taureau quitte l’arène, il est découpé. Les différentes parties du corps sont vendues au marché de la ville, ce qui n’a pas toujours été le cas (lorsque la noblesse gardait les pièces du taureau). La popularité actuelle de la corrida provient en grande partie de ce partage culinaire !
Puis je rencontre Alice, une Erasmus italienne vivant à Séville avec 20 autres étudiants ! Merci CouchSurfing ! On se retrouve au bar « Er Tito », en face des Beaux-Arts de Séville. Elle me présente à ses amis (principalement italiens) et m’invite à boire un alcool, une spécialité non pas locale mais… italienne ! Ces italiens, ils restent fidèles à eux-même !
Quel bonheur de retrouver le temps d’un verre l’ambiance Erasmus, avec ses joies, ses peines (certaines colocataires étaient partis la veille), bref : la vie ! On discute quelques heures ensemble et je peux enfin vraiment parler espagnol (et pas rester frustré à juste passer une commande dans un restaurant ou demander la cuenta !), puis je les laisse pour assister à un concert de guitare romantique dans l’enceinte même des remparts de la ville : Alcazar.
A nouveau, voici mes notes sur ce concert magique :
Le concert de guitare classique était merveilleux. Le guitariste donnait de l’Amour, de la douceur.
Il n’y a pas de heurts à Séville. Zéro violence ni agressivité. Ici, tout est romantique. Il faisait beau, tiède avec un léger vent frais et le public – espagnol pour la plupart – écoutait le son de l’instrument à la belle étoile. Le bleu du ciel, clair au début du concert et foncé à sa fin était en dégradé, répondant aux aplats orangés du corridor éclairé et au jaune des lumières pour la muraille. Le tout créait une composition musico-pictorale, en plein air.
Les constellations supervisaient.
Je rentre à l’hôtel où mes doses d’émotion et de mélanine sont à leur maximum ! C’était sans compter sur cette autre rencontre.
Camilla a 21 ans, elle est de Milan. Sa voix est aussi douce que la ville et on s’est mis à discuter dans la pénombre. C’est incroyable comment par moments, deux êtres peuvent commencer à discuter comme ça, quasiment sans contexte et de manière évidente, simple, pure ! On ne se connaissait pas et en même temps, nous n’avions pas besoin d’en savoir plus sur l’autre pour partager et s’écouter. Elle descend pour demander quelque chose à la réception, je monte sur la terrasse de l’hôtel et écris.
Le lendemain matin, on se recroise (dans des dortoirs de 8 personnes ce n’est pas très compliqué !), on échange nos coordonnées. Je découvre son prénom. Un ange passe.
Je continue les jours qui suivent les visites et prends de plus en plus le temps pour apprécier le soleil et la contemplation. Mes sens passent de la saturation parisienne à l’éveil andalous. On reprend conscience de son corps. Pour poursuivre dans cette optique, je vais aux bains arabes : bains de plus en plus chauds, hammam et douche froide. Je ponctue cette activité par un massage relaxant :-).
La soirée restera sur le thème arabisant puisque je retourne aux concerts d’Alcazar pour écouter cette fois-ci un groupe de musique du Maghreb/Moyen-orient, nommé « Amineh » qui interprètera des morceaux traditionnels marocains, turcs et grecs principalement.
Je terminerai cet article par deux points introspectifs. L’un destiné à une amie très proche que j’ai écrit pendant mon voyage à Séville justement. J’espère qu’elle ne m’en voudra pas de dévoiler ce message à autant de personnes d’un seul coup ! Je ne l’ai pas traduit donc il est en espagnol.
Joder Mori me siento muy raro esos días. Debe ser el viaje pero tengo miedo de pasar al lado de mi propria vida.
Parece una tontería pero tengo la sensación que mi objetivo en esta Tierra es de dar amor. Tengo algo dentro de mi, cómo una energía positiva que tiene que salir para dar, compartir cosas buenas en la vida como música, relaciones humanas, sueños, esperanza.
Parece muy naivo y idealista pero es el fundo verdadero de mi sensación actual. Estoy desarollando el punto de vista que tengo del ser humano y de la humanidad. No sé, es muy raro todo eso.
Ayer, he tenido una foto que saqué yo en media-pagina de una revista politica/generalista muy muy famosa en Francia. Toda la gente me ha llamado, mi madre lo dijó a la Tierra entera tanto orgullosa estaba !!!
Pero primero no es una foto estupenda y segundo, temo que este mundo da importancia a cosas futiles, sin importancia justamente !
Cuando estuve en los conciertos dentro de Alcazar ayer y anteayer, los músicos daban amor con la música y su interpretación. Era un encanto, una emocíon pura, positiva y valerosa. Eso es la vida : alguien generoso que te ofrezca su alma, su bondad y su benevolencia.
Me siento tan lejos de la vida superficial y sin valores buenas de París…
Me dijiste que tengo el sol dentro de mi. No sé de eso pero desde que me lo has dicho, veo la gente en dos partes : los que vienen del sol o quien tienen un sol y los demás.
Me alejo mucho de la mayoria de mis amigos « antiguos » por este razón. Los falta la luz, la felicidad.
Bueno, tal vez eso es solo una pasada pero me pregunto muchas cosas esos días.
Agradezco la vida de haber podido conocerte chica especial !
Et enfin, un extrait d’une pensée écrite le 9 juillet dernier :
[…] A nouveau, entre le confort et la vie on préfère le premier. Le poids du regard des autres est immense car il fait écho non pas à un problème avec soi-même mais aux blocages et aux codes réducteurs sociaux de l’ensemble de la société.
Il faut avoir une force incroyable, une confiance en soi sans limite et une paix intérieure entière pour passer outres ces règles relationnelles réductrices.
La vraie liberté, c’est celle de l’Être. Pour moi, ce sont les personnalités solaires. Elles rayonnent, n’ont aucun recoin intérieur caché, ni zones d’ombres. On peut les lire, les écouter et tout est limpide, transparent.
Ces gens-là sont positifs, profitent de la vie et partagent leur bonheur par une communication aussi simple que pure.
Ils sont beaux car ils voient tout par le prisme de la beauté.

"Digne". Bourges, France.